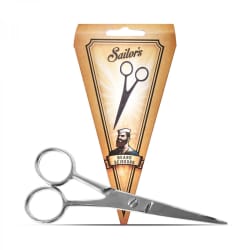Histoire du rasage classique et de la barbe
Five o’clock, Goatee, Franz-Josef, Favoris de marin, Royale,
Bande de menton, Victor Emanuel, Bacchantes, Van Dyke et Verdi.
Rédigé avec le barbier Simon
Si certains de ces termes vous sont familiers, vous aurez compris que nous abordons ici une étude de style à travers le vaste et éclectique catalogue de la mode de la barbe. Tout comme les techniques et outils du rasage classique ont évolué au fil du temps, la parure masculine du visage a traversé différentes phases au cours des siècles. Suivons ensemble ces deux histoires.

La mode et la beauté, sous toutes leurs formes, sont traditionnellement associées aux femmes à l’époque moderne, mais un rapide coup d’œil dans l’histoire révèle que les tendances ont souvent eu les hommes pour cible, et que ce sont eux qui, bien souvent, en ont dicté les orientations. Coiffures, vêtements, perruques, styles de barbe et même maquillage dans des styles parfois extravagants et raffinés sur les portraits historiques témoignent de la manière dont les attributs extérieurs servaient à affirmer pouvoir, identité ou singularité.
Remontons le temps, à l’époque préhistorique, où les hommes étaient déjà soucieux de leur apparence, souvent pour des raisons spirituelles. Le maquillage et les coiffures portaient une symbolique religieuse ou rituelle, comme en témoignent les peintures corporelles des civilisations anciennes. On ignore pourquoi, dès 30 000 av. J.-C., l’homme a commencé à se raser, mais il est probable que les hommes des cavernes aient découvert que le silex pouvait être taillé pour servir de lame de rasoir. Des tentatives avec des coquillages ont également été faites, jusqu’à ce que, vers 3000 av. J.-C., le travail du métal ouvre la voie à de nouveaux outils et méthodes pour éliminer la pousse de la barbe. Ce n’était certes pas encore du Gillette ou du Feather, mais c’était un début.
Le maquillage et les coiffures portaient une symbolique religieuse ou rituelle.
Dans l’Antiquité, la forme et la longueur de la pousse de la barbe définissaient de plus en plus le statut et l’appartenance sociale. Dans l’Égypte ancienne, la longue barbe carrée – teinte au henné, tressée de fils d’or, de laine et de feuilles de palmier, et parfumée – était le signe distinctif de la noblesse et des plus hauts rangs. Les souverains, considérés comme divins, portaient même une fausse barbe en métal brillant, attachée au menton par un ruban doré, la pointe relevée pour souligner leur statut divin. Impossible de faire plus prestigieux.
Les Égyptiens étaient par ailleurs obsédés par l’idée d’éliminer tout poil. Seuls les plus hauts dignitaires étaient autorisés à porter la barbe, tandis que le peuple et les esclaves devaient être parfaitement rasés. Non seulement la tête, mais toute pilosité corporelle était sacrifiée au coupe choux (un idéal qui semble avoir retrouvé ses lettres de noblesse aujourd’hui). À la place, on portait des couvre-chefs pour protéger le crâne nu du soleil brûlant. Les plus fortunés arboraient d’impressionnantes perruques, ornées des mêmes matériaux que ceux utilisés pour les barbes. Cette frénésie du rasage classique avait aussi une dimension pratique : dans un climat aussi chaud, une chevelure longue ou une barbe fournie favorisait la vermine, les poux et une mauvaise hygiène, même si les Égyptiens se baignaient fréquemment.
Moïse est souvent cité comme l’archétype du chef sage et barbu, et la Bible elle-même indique que l’élu de Dieu devait porter la barbe. Jeune homme, Moïse était probablement rasé de près, comme tous les « mortels » d’Égypte, et il dut profondément choquer le pharaon Ramsès II lorsqu’il se présenta, la chevelure longue et la barbe pleine, pour réclamer la liberté de son peuple (déjà un affront en soi). Après Moïse, la barbe devint un symbole de pouvoir et de leadership, comme en Inde ancienne, où une longue barbe soignée était signe de sagesse. Se faire raser la barbe publiquement constituait d’ailleurs la pire humiliation pour certains crimes graves.
Les Égyptiens étaient obsédés par l’idée d’éliminer tout poil.
Comme en Inde, la barbe était entretenue avec un soin extrême au Moyen-Orient, où, notamment en Assyrie, elle était huilée et bouclée en de véritables œuvres d’art (les Perses et les Babyloniens auraient été parmi les premiers à inventer des outils pour cela – pensez-y, amateurs de fer à friser !). C’est également à Babylone, sous le règne d’Hammurabi, vers 1700 av. J.-C., que l’on trouve les premières références au métier de barbier.
Dans la Grèce antique, la barbe était synonyme de statut, de sagesse et de puissance sexuelle, et l’on se rasait rarement. Elle devait être soigneusement entretenue, huilée et bouclée, comme en témoignent les nombreuses statues et bustes produits par les Grecs. Mais tout changea avec Alexandre le Grand. Soucieux de son apparence, il fut le premier à privilégier un visage rasé de près, ce qui s’avéra aussi pratique lors de ses campagnes militaires. Il avait remarqué que les Perses, au combat, saisissaient la barbe de leurs adversaires pour les tuer plus facilement, et il exigea bientôt – au grand effroi de ses soldats – que tous soient rasés de près. Les résultats sur le champ de bataille ne se firent pas attendre, et dès lors, les portraits royaux sans barbe se multiplièrent, comme en témoignent plusieurs monnaies de l’époque. L’idéal fut même officialisé par une interdiction de la barbe. À cette période, seuls les philosophes ou les enseignants portaient la barbe. Ou alors, on n’était tout simplement pas digne de confiance.
Prenez soin de votre barbe
Les Romains poursuivirent d’abord dans la même voie, et dans la Rome antique après 300 av. J.-C., la pousse de la barbe était considérée comme négligée (seuls le deuil ou la perte d’un proche justifiaient de laisser pousser la barbe). Le premier rasage d’un jeune homme de 17 ans devenait un rite d’initiation symbolisant l’entrée dans l’âge adulte, et les poils rasés étaient offerts aux dieux. Mais, plus tard sous l’Empire, la tendance s’inversa : les empereurs recommencèrent à porter la barbe, d’abord en ne se rasant que partiellement et en huilant les zones conservées (favoris, etc.), puis en adoptant la barbe complète. L’empereur Hadrien fut le premier à imposer ce nouvel idéal, qui se répandit chez ses successeurs. La barbe pleine devint alors la norme, inspirée par l’admiration des Romains pour la haute culture grecque d’avant Alexandre. Mais certains prétendent que la véritable raison pour laquelle Hadrien laissa pousser sa barbe était de masquer ses problèmes de peau. Et l’on sait bien que Clearasil n’existait pas à l’époque romaine.
Le tsar Ivan le Terrible de Russie était quant à lui un partisan pragmatique de la barbe.
Au Moyen Âge, la perception de la barbe était pour le moins chaotique, oscillant entre pilosité faciale et rasage complet selon la région et l’époque. Guillaume le Conquérant voyait d’un mauvais œil la passion des Anglo-Saxons pour la moustache, tandis que le tsar Ivan le Terrible était un fervent défenseur de la barbe. Ce n’est qu’avec Pierre le Grand que la mode changea en Russie, la barbe étant bannie (les nobles récalcitrants devaient payer des taxes et amendes s’ils refusaient de se raser).
L’Église médiévale avait une attitude fluctuante et confuse envers la barbe : monastères et cathédrales étaient peuplés de prêtres tantôt barbus, tantôt rasés. Mais en 1096, l’évêque de Rouen mit fin à cette « mode pécheresse » dans l’Occident chrétien, et ceux qui refusaient de se raser étaient exclus de l’Église (une catastrophe sociale à l’époque). À l’Est, la vision était différente : chez les chrétiens orthodoxes et les juifs orthodoxes, la pilosité faciale, comme pour Moïse, était un signe de sagesse et une marque divine – sortir le coupe choux revenait à se castrer, tant sur le plan religieux que social (cette symbolique s’est aussi retrouvée chez les sikhs et dans l’islam).
Les chevaliers du Moyen Âge étaient presque toujours rasés de près, oubliez donc les petites barbes pointues et longues moustaches vues dans les films ou illustrations. Pour un chevalier, la pilosité faciale était incompatible avec le port du heaume, et il fallut attendre la fin du Moyen Âge pour que la barbe redevienne à la mode, même dans les milieux ecclésiastiques.
Avec de telles fluctuations, la situation était naturellement instable pour les barbiers, qui durent élargir leurs services à des pratiques que l’on associe aujourd’hui aux chirurgiens et dentistes – une évolution facilitée par le fait que les moines et hommes d’Église (traditionnellement chargés des soins) furent interdits, par décret papal, de toute activité impliquant du sang ou des fluides corporels. Le barbier ne se contentait donc plus de manier le coupe choux, mais devait aussi pratiquer des amputations – souvent avec des conséquences désastreuses, voire mortelles – ainsi que la saignée et des extractions dentaires. Les chirurgiens ambulants des champs de bataille aux XVIIIe et XIXe siècles étaient à l’origine des barbiers, et il n’était pas rare qu’un soldat commence sa journée par un rasage classique et la termine, après la bataille, par une amputation réalisée par la même main.
Vous connaissez sans doute l’enseigne classique rouge et blanche des barbiers ? Peu savent que les bandes rouges sur fond blanc remontent à cette époque, lorsque les serviettes blanches du barbier étaient tachées du sang des « patients ». Un exemple de design à la fois décoratif et porteur d’une signification historique insoupçonnée !
Les bandes rouges sur fond blanc remonteraient à l’époque où les serviettes du barbier étaient tachées du sang des « patients ».
À la Renaissance, la mode et la coquetterie masculines s’épanouissent pleinement chez les rois et la haute société. Observez les portraits de Gustave Vasa, Éric XIV ou Henri VIII d’Angleterre : pouvoir et richesse s’y affichent dans les tenues les plus somptueuses et extravagantes – une démonstration d’orgueil assumé. Au milieu de cette profusion de soies et d’accessoires colorés, la barbe connaît une véritable renaissance, chacun rivalisant d’inventivité dans la forme de ses moustaches et barbes effilées (et parfois les plus longues) – « less is more » n’aurait pas été le mot d’ordre de l’époque. La tendance se poursuit au XVIIe siècle, où les fines barbes et moustaches torsadées s’associent à de longues chevelures naturelles dignes du Woodstock des années 1960-70.
Mais au XVIIIe siècle, la perruque (apparue à la fin du XVIIe avec Louis XIV) devient aussi incontournable dans les salons aristocratiques que la langue française, et elle gagne en volume, en boucles et en extravagance. La perruque s’imposant comme symbole de statut, la barbe devient superflue et même inappropriée avec les visages poudrés. Teint hâlé et pilosité faciale étaient alors réservés aux paysans et aux indigents, catégories avec lesquelles personne ne voulait être associé. Seuls les officiers de l’armée conservaient parfois la moustache, une tendance qui perdurera dans les milieux militaires pendant plusieurs siècles.
Au début du XIXe siècle, après la chute de la Révolution française, poudres et perruques masculines sont reléguées aux oubliettes et une incroyable renaissance de la barbe et de la pilosité faciale s’amorce. Tout commence avec les favoris, qui, dans les cas extrêmes des années 1830, descendent jusqu’aux commissures des lèvres, couvrant les joues et le cou (particulièrement prisés par les puissants et les intellectuels). Nous entrons dans l’ère romantique, où tout est exagéré. S’ensuit une véritable forêt de moustaches et de barbes, dans toutes les variantes imaginables. Ne pas porter de barbe ou de moustache, c’était être démodé. Pensez à Abraham Lincoln (premier président américain barbu), Johann Strauss fils, Johannes Brahms, Charles Dickens ou Karl Marx – pour ne citer que quelques exemples. La tendance se poursuit à la fin du XIXe siècle et à l’époque victorienne tardive, mais dans un style plus subtil où la barbe complète cède du terrain à la moustache. Sur les photos des années 1870 jusqu’au tournant du XXe siècle, presque tous les hommes adultes arborent une moustache (plus ou moins fournie, fine ou soigneusement cirée) – on pourrait croire à des clones.
En 1907, on tenta d’instaurer une « taxe sur la barbe » : porter la barbe signifiait non seulement être sale, mais aussi avoir quelque chose à cacher, disait-on.
Puis vint la Première Guerre mondiale, et le masque à gaz devint un accessoire courant. La mode changea à nouveau : être rasé de près devint une nécessité, notamment pour garantir l’étanchéité du masque. C’est aussi à cette époque que la lame de rasoir moderne et le rasoir de sécurité remplacèrent peu à peu le coupe choux, rendant le rasage classique plus facile et agréable. Dès les années 1920, les moustaches disparaissent, laissant place à des visages lisses. Si vous en doutez, regardez les photos des années folles ou les vieux films de gangsters. L’entre-deux-guerres et les années autour de la Seconde Guerre mondiale furent marquées par une « hystérie hygiéniste » et toutes sortes d’arguments (sensés ou farfelus) furent avancés contre la barbe et les poils du visage. Dès 1903, un article du Chicago Chronicles affirmait qu’une barbe pouvait contenir en moyenne 200 000 (!) microbes – la barbe était donc jugée répugnante et impure. Dans le New Jersey, la paranoïa atteignit son comble en 1907, avec une tentative d’instaurer une « taxe sur la barbe » : porter la barbe signifiait non seulement être sale, mais aussi avoir quelque chose à cacher. Le rasage classique devint un « acte moral » à encourager (voire imposer) par la propagande.
Produits parfaits pour le rasage classique
Dans les années 1950, marquées par la liberté et la consommation (où la voiture, la télévision et la culture américaine influencent la mode et le quotidien dans tout l’Occident), un changement subtil s’amorce. Pour la première fois, ce ne sont plus les autorités ou les rois qui dictent la tendance, mais de nouvelles icônes : acteurs, rock stars et célébrités. Sur grand écran, des idoles masculines comme Errol Flynn et Clark Gable inspirent de nombreux hommes à porter une moustache élégante, mais à partir des années 1950, la jeunesse impose ses propres tendances en matière de pilosité faciale.
Les premiers signes apparaissent avec les longues et larges favoris d’Elvis, descendant sur les joues (souvent taillés avec des contours nets), puis, dans les années 1960, le bouc et la moustache retrouvent leur place, notamment chez les artistes et les musiciens de jazz. Avec l’avènement des Beatles, la rupture est consommée : les cheveux s’allongent, et la guerre du Vietnam ainsi que les mouvements contestataires de la fin des années 1960 et du début des années 1970 font de la barbe et des poils du visage le symbole d’une volonté de liberté et d’un rejet du style rasé de près associé aux soldats. Pendant la période hippie pacifiste – John Lennon inventa d’ailleurs les expressions « hair peace » et « beard peace » – on assiste à une véritable anarchie capillaire. La liberté est totale, la « naturalité » prime.
En bon yuppie, vous pouviez manier le rasoir électrique avec la rapidité et l’élégance d’une panthère.
Dans les années 1980, glamour et superficialité obligent, la tendance s’inverse radicalement. Les cheveux longs disparaissent, et le visage rasé de près redevient la norme. En bon yuppie, vous pouviez manier le rasoir électrique avec la rapidité et l’élégance d’une panthère, posséder des voitures de luxe et des cheveux crêpés et décolorés. Les vêtements devaient être de marque, jamais des copies bon marché, pour afficher votre réussite. Le style se voulait lisse et juvénile – dans un tel contexte, la barbe n’avait pas sa place. Mais avec la vague grunge des années 1990, la barbe – en particulier le bouc et la barbiche (pensez à Kurt Cobain de Nirvana) – fait un retour remarqué, et depuis, la perception de la barbe a changé : arborer une barbe n’a plus nécessairement de signification symbolique, politique ou religieuse, mais peut simplement être séduisant. Il est devenu tout à fait acceptable d’avoir une barbe de trois jours ou une barbe complète, même dans des contextes plus formels, tout comme il est parfaitement admis d’être rasé de près.
Aujourd’hui, la barbe complète connaît une renaissance spectaculaire chez les jeunes comme chez les plus âgés, mais le choix est plus libre que jamais. Comme les artistes ne sont plus tenus à un style musical unique pour être « tendance », la mode et l’apparence sont désormais marquées par une grande liberté personnelle. Les artistes et les médias continuent de nous influencer, sans doute autant qu’autrefois, mais chacun est libre de suivre la voie qui lui convient. Quel que soit le style choisi, il doit vous correspondre, et puisque la mode évolue sans cesse, c’est sans doute la leçon la plus précieuse que nous enseigne l’histoire.